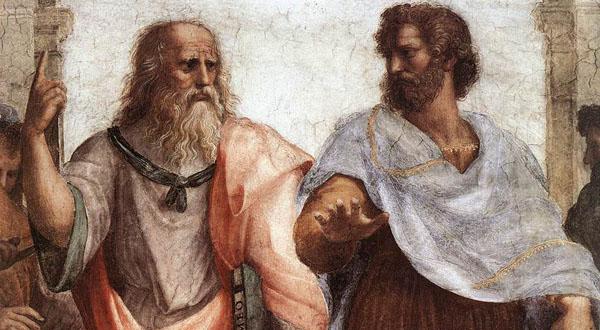SPINOZA (1632 - 1677) Article Wikipédia ici
–Acquiescentia in se ipso –Action –Adam –Affect –Affect et pouvoir de l'esprit –Affectio –Affect et association –Affection et corps –Affectus / affectio –Affect et moralité –Affect et psychanalyse –Affects primitifs –Ambition –Ame –Amitié –Amour –Amour intellectuel de Dieu –Appétit –Attribut –Automate spirituel –Béatitude –Béatitude et affectivité –Bien & Mal –Bienveillance –But du T.T.P ––Bon & mauvais –Causa sui –Cause –Cause adéquate / inadéquate –Causes finales –Christ –Colère –Cogito –Commandements de la Raison –Conatus –Connaissance –Confiance –Conscience –Contentement –Contingence –Corps –Corps humain –Crainte –Création –Décret / délibération –Démocratie –Désir –Deus –Distinction –Distinction des affects –Doute –Doute cartésien –Droit –Dualisme –Durée –Ecriture –Election –Eminence –Entendement –Espoir –Esprit –Essence –Etat –Etat de nature et état de société de l'homme –Etendue –Eternité –Etonnement –Etre –Etre actif / passif –Être de l'Essence, de l'Existence, de l'Idée et de la Puissance –Etre de raison –Etre fini –Expliquer –Expression –Facies totius universi –Fausseté –Fermeté / générosité –Foi –Formellement / Eminemment –Haine –Homme –Humanité –Idée –Idée adéquate –Imagination – Impossible/nécessaire/possible –Individu –Infini –Intellect –Interprétation –Jalousie –Joie –Liberté –Loi –Mémoire –Méthode -Miracle –Mode –Modes infinis immédiats, médiats, modes finis –Mort –Natura –Nature naturante –Nature naturée –Néant –Nécessité -Nostri corporis affectus –Notion commune –Ordre –Orgueil –Panthéisme –Parallélisme –Parallélisme épistémologique–Passion –Pensée –Perfection divine / imperfection des effets –Philosophie –Pitié –Plaisir –Plan –Plan du livre III –Privation / Négation –Problème de la définition des affects –Prophétie –Providence –Puissance –Raison –Rapport corps / esprit –Réalité –Réalité objective de l'idée –Réalité / perfection –Refoulement –Religion –Rencontre –Révélation –Rire –Salut –Secours interne/externe –Servitude –Spinozisme –Substance –Temps –Théologico-politique –Tout / partie –Traduction d'affectus –Tristesse –Unité –Variation –Vérité –Vie –Vertu –Volonté
Acquiescentia in se ipso : "La Satisfaction de soi-même est une joie qui naît de ce qu'un homme se contemple lui-même, ainsi que sa puissance d'agir" (Ethique, III, Définitions des affects, XXV, p.317) "La Satisfaction de soi-même peut naître de la raison, et seule la satisfaction qui naît de la raison est la plus haute qui puisse exister." (IV, 52 trad. Pautrat) "Nous comprenons par là clairement en quoi consiste notre salut, ou béatitude, ou Liberté, à savoir dans un Amour constant et éternel envers Dieu, autrement dit dans l'amour de Dieu pour les hommes. (...) Car, cet amour se rapporte à Dieu ou bien à l'Esprit, c'est à bon droit qu'on peut l'appeler Satisfaction de l'âme (Animi acquiescientiam), laquelle en vérité ne se distingue pas de la gloire (...) Car, en tant qu'il se rapporte à Dieu (par la Prop.35 de cette p.), c'est une Joie, s'il m'est encore permis d'user de ce vocable, qu'accompagne l'idée de soi, et de même aussi en tant qu'il se rapporte à l'Esprit (par la Prop. 27 de cette p.)" (id, V, 36, Scolie p.531)
Action : "bene agere et laetari." "bien agir et être joyeux" (*Scolie 73 / IV) "injurias aequo animo ferre." "supporter les offenses avec sérénité" (*Chapitre 14 / IV) "L'esprit cherche à être la cause adéquate de ce qui lui arrive, à être actif, à s'affirmer, à réaliser sa nature humaine" (Intro Caillois p.29) "Plus chaque chose a de perfection, plus elle agit et moins elle est passive ; inversement, plus elle agit, plus elle est parfaite.PPlus" (V, 40) "...il suit que pâtit le plus l'Esprit dont les idées inadéquates constituent la plus grande part, en sorte qu'on le reconnaît plus par ce qu'il pâtit que par ce qu'il agit ; et, au contraire, qu'agit le plus celui dont les idées adéquates constituent la plus grande part, en sorte que, tout en ayant en lui autant d'idées inadéquates que l'autre, on le reconnaît pourtant plus à celles-là, qu'on attribue à la vertu humaine, qu'à celles-ci, qui plaident en faveur de l'impuissance humaine." (Ethique, V, 20, scolie, trad Pautrat)
Affect (affectus) : "que on appellera affect tout mode de pensée qui ne représente rien" (...) "le fait de vouloir n'est pas une idée, c'est un affect parce que c'est un mode de pensée non représentatif" (...) "En tant qu'automates spirituels, il y a tout le temps des idées qui se succèdent en nous, et suivant cette succession d'idées, notre puissance d'agir ou notre force d'exister est augmentée ou est diminuée d'une manière continue, sur une ligne continue, et c'est cela que nous appelons affectus, c'est ça que nous appelons exister. L'affectus c'est donc la variation continue de la force d'exister de quelqu'un, en tant que cette variation est déterminée par les idées qu'il a." (...) "l'affect est déterminé par les idées qu'on a, il ne se réduit pas aux idées qu'on a, il est déterminé par les idées qu'on a; donc ce qui est essentiel c'est de voir un peu quelles sont ces idées qui déterminent les affects, tout en gardant bien présent dans notre esprit que l'affect ne se réduit pas aux idées qu'on a, il est absolument irréductible." (Deleuze, cours sur Spinoza à l'université de Vincennes, 24/01/78) "...l'affect recouvre une réalité physique (certaines affections du corps) et une réalité mentale (les idées de ces affections). Il les tient ensemble et les englobe en même temps. L'affect exprime la simultanéité, la contemporanéité de ce qui se passe dans l'esprit et dans le corps." (Jaquet, L'unité du corps et de l'esprit, p.21) <Per affectum intelligo corporis affectiones quibus ipsius corporis agendi potentia augetur vel minuitur, juvatur vel coercetur et simul harum affectionum ideas. Si itaque alicujus harum affectionum adæquata possimus esse causa, tum per affectum actionem intelligo, alias passionem.> "Par sentiments, j'entends les affections du corps, par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est augmentée ou diminuée, aidée ou contenue, et en même temps les idées de ces affections. Si donc nous pouvons être cause adéquate de quelqu'une de ces affections, j'entends alors par sentiment une action; dans les autres cas, une passion." (III définition 3) "De ce qui augmente ou diminue, aide ou contrarie la puissance d'agir de notre corps, l'idée augmente ou diminue, aide ou contrarie la puissance de penser de notre esprit." (III proposition 11) "L'Affect, qu'on dit une Passion <Pathema>de l'âme, est une idée confuse, par laquelle l'Esprit affirme une force d'exister <existendi vim> de son Corps, ou d'une partie de son Corps, plus grande ou moindre qu'auparavant, et dont la présence détermine l'Esprit lui-même à penser à ceci plutôt qu'à cela." (III, définition générale des sentiments, trad. Pautrat) "Mais il faut remarquer que quand je dis : une force d'exister plus grande ou moindre qu'auparavant, je n'entends pas par là que l'Esprit compare l'état présent du corps avec son état passé ; mais que l'idée qui constitue la forme de l'affect affirme du Corps quelque chose qui enveloppe, en vérité, plus ou moins de réalité qu'auparavant." (ibid)"Un affect ne peut être contrarié ni supprimé que par un affect contraire et plus fort que l'affect à contrarier." (Ethique, IV proposition 7, trad. Pautrat) "Un sentiment, dont nous imaginons la cause actuellement présente, est plus fort que si nous imaginions cette cause non présente." (Ethique, IV, 9) "Un sentiment qui est une passion, est une idée confuse. Si donc nous formons de ce sentiment une idée claire et distincte, cette idée ne se distinguera du sentiment lui-même, -en tant qu'il est rapporté à l'esprit seul, -que par une raison, et par conséquent le sentiment cessera d'être une passion." (V, démonstration de la proposition 2) "Un sentiment est donc d'autant plus en notre pouvoir, et l'esprit est par lui d'autant moins passif, qu'il nous est mieux connu." (corollaire de supra) "…en dehors de ce remède aux sentiments, qui consiste dans leur connaissance vraie, on n'en peut concevoir aucun autre qui soit supérieur et dépende de notre pouvoir, puisqu'il n'y a aucune autre puissance de l'esprit que celle de penser et de former des idées adéquates." (V, scolie de la proposition 4) "Les affects qui naissent de la raison, ou sont excités par elle, sont, si l'on tient compte du temps, plus puissants que ceux qui se rapportent aux choses singulières que nous contemplons comme absentes" (V, proposition 7, trad. Pautrat) "L'esprit n'est soumis que pendant la durée du corps aux sentiments qui se rapportent à des passions." (V, 34) "D'où suit qu'aucun amour, sauf l'amour intellectuel, n'est éternel." (corollaire de supra) "Dans le Court Traité, les sentiments ne sont pas expliqués à partir de l'effort qui constitue notre essence individuelle, mais à partir des degrés de notre connaissance : "Les sentiments naissent de l'opinion". La théorie des sentiments, contrairement à ce qui aura lieu dans l'Ethique, n'est pas ici subordonnée à une théorie de l'âme. Et, d'autre part, nulle déduction systématique des sentiments n'est proposée." (Le Ratio. de Spinoza, p.286) "Selon Descartes, tous les sentiments sont des "passions de l'âme". Au contraire, Spinoza distingue avec soin les termes affectus et passio, et, des sentiments "qui sont des passions", sépare ceux "qui se rapportent à nous en tant que nous sommes actifs <Ethique, III, 58>". Il parle d'un "désir tirant son origine de la raison"." (Le Ratio. de Spinoza, pp.304-305) "...il n'est pas le premier à avoir analysé les affects comme des manifestations conjointes du corps et de l'esprit et à avoir fonder un discours mixte. Déjà dans la Lettre à Elisabeth du 21 mai 1643, Descartes précisait que les passions relèvent de l'union de l'âme et du corps et s'expliquent à partir de cette notion primitive. Les passions ne dépendent donc ni de l'âme seule, ni du corps seul, mais du corps et de l'âme ensemble." (Jaquet, l'Unité du corps et de l'esprit, p.23) "Descartes, en effet, admet lui aussi dans une certaine mesure l'idée d'une affectivité active, car il distingue deux types d'émotions, "des émotions intérieures qui ne sont excitées en l'âme que par l'âme même" <Passions de l'âme, II, 147> , et les émotions passives qui sont causées par le corps. Les émotions intérieures ou intellectuelles impliquent en même temps une action et une passion de l'âme, car celle-ci est à la fois l'agent qui les cause et le patient qui les ressent." (id p.25) Spinoza identifie l'animi commotionem à l'affectus. cf Ethique, V, 2 (Pautrat) : "Si nous éloignons une émotion de l'âme, autrement dit un affect (...)". / "...la philosophie de Spinoza est franchement novatrice puisqu'elle engage l'affectivité vers des lois générales alors que la tradition la rapporte à des entreprises désordonnées et déconcertantes. Une telle philosophie tente d'élaborer un point de vue rationnel sur l'affectivité, faisant de l'organisation de la vie affective, un objet réel de connaissance pour fonder une éthique." (Spinoza et les Affects, p.5) les affects "...relèvent d'une logique rigoureuse, celle des géomètres et il faut les consiérer comme s'il était question de lignes, de plan et de solides." (id, p.6) "Les affections sont à la fois des modes de la substance et les modifications de ces modes en tant qu'ils produisent des effets les uns sur les autres selon un régime que l'on peut appeler affectivité et qui implique un certain état dont les degrés de perfection ou affects sont variables." (id, p.9)
Affect et association : "Si l'esprit a été affecté par deux sentiments en même temps, lorsque, dans la suite, il sera affecté par l'un d'eux, il sera aussi affecté par l'autre." (Ethique, III, 14) "N'importe quelle chose peut être, par accident, cause de joie, de tristesse ou de désir." (id III, 15) "Du seul fait que nous imaginons qu'une chose (rem) a quelque ressemblance avec un objet (objecto) qui provoque d'ordinaire dans l'esprit joie ou tristesse, -et bien que l'élément de ressemblance avec l'objet ne soit pas la cause efficiente de ces sentiments, - nous aimerons cependant cette chose ou la haïrons." (id III, 15)
Affect et moralité : "La connaissance du bien et du mal n'est rien d'autre que l'affect de Joie ou de Tristesse, en tant que nous en sommes conscients." (Ethique IV, 8 trad. Pautrat) "La vraie connaissance du bien et du mal, en tant que vraie, ne peut contrarier aucun affect, mais seulement en tant qu'on la considère comme un affect." (IV, 14 trad. Pautrat) "Le projet pratique de l'Ethique, qui est de montrer comment on peut passer de la servitude passionnelle à la liberté de la raison, est donc indissociable d'une théorie de l'affectivité expliquant comment aller de la tristesse à la joie et des passions aux actions." (J-M Vaysse, "Joie, Mort, Angoisse" in Spinoza et les Affects, p.9)
Affect et pouvoir de l'esprit : "...j'ai embrassé tous les remèdes aux affects, autrement dit, tout ce que l'Esprit, considéré en lui-même, peut contre les affects ; d'où il appert que la puissance de l'Esprit, considéré en lui-même peut contre les affects ; d'où il appert que la puissance de l'Esprit sur les affects consiste ; (I) dans la connaissance même des affects ; (II) en ce qu'il sépare les affects d'avec la pensée d'une cause extérieure, que nous imaginons confusément ; (III) dans le temps, grâce auquel les affections qui se rapportent à des choses que nous concevons de manière confuse ou mutilée ; (IV) dans le très grand nombre des causes qui alimentent ces affections se rapportant aux propriétés communes des choses ou à Dieu ; (V) enfin, dans l'ordre dans lequel l'Esprit peut ordonner et enchaîner entre eux ses affects (...) pâtit le plus l'Esprit dont les idées inadéquates constituent la plus grande part, en sorte qu'on le reconnaît plus par ce qu'il pâtit que par ce qu'il agit." (Ethique, V, 20 scolie, trad. Pautrat)
Affect et psychanalyse : "Chaque affect, écrivait Wundt, débute par un sentiment initial (Anfangsgefühl) plus ou moi ns intense, caractéristique, de par sa qualité et sa direction, par la production de l'affect, et qui prend source, ou bien dans une représentation provoquée par une impression extérieure, ou nien dans un processus psychique survenant en vertu de conditions associatives ou aperceptives. S'ensuit alors un processus représentatif accompagné d'un sentiment correspondant, qui apparaît caractéristique, respectivement, de chacun des affects particuliers, en raison de la qualité du sentiment et de la vitesse du processus. Enfin, l'affect se conclit avec l'accompagnement d'un sentiment d'achèvement, qui au terme de ce processus aboutit à une situtation de repos, dans laquelle s'éclipse l'affect." (L'apport freudien... art. "Affect", p.14) / Pour Freud l'affect à comme le pouvoir d'une charge électrique, capable d'investir d'énergie des représentations (il y a des représentations "chargées" d'affect). Certaines représentations "chargées" d'affects négatifs, nuisant à la joie de vivre, etc. sont donc écartées ou refoulées dans ce que Freud appelle les "Neuropsychoses de défense" /
Affectio : "Contrairement à celui d'"affect", le terme d'"affection" ne fait pas l'objet d'une définition en bonne et due forme. Néanmoins, Spinoza explicite la nature et la signification de ce concept au cours de son analyse finale du désir. "Par affection de l'essence humaine, nous entendons n'importe quel état (constitutionem) de cette essence, qu'il soit inné ou non, qu'il se conçoive par le seul attribut de la pensée, ou par le seul attribut de l'étendue, ou enfin qu'il se rapporte en même temps à l'un ou à l'autre de ces attributs." <Ethique III, définitions des affects, déf.1, explication>. L'affection de l'essence humaine en général désigne donc soit un état mental qui s'explique par référence à la pensée, soit un état physique qui s'explique par rapport à l'étendue, soit un état psychophysique qui s'explique par référence aux deux attributs." (...) "L'affection ne touche pas le corps seul, elle concerne également l'esprit seul, ou bien encore l'esprit et le corps pris ensemble. Ainsi, le tremblement, la pâleur, le rire et les larmes sont des affections qui se rapportent au corps seul, (...) "(Jaquet, L'unité du corps et de l'esprit, p.85) "Le Corps humain peut être affecté de bien des manières qui augmentent ou diminuent sa puissance d'agir, ainsi que d'autres qui ne rendent sa puissance d'agir ni plus grande, ni plus petite" (Ethique, III, postulat 1, trad. Pautrat) "Ainsi, le fait que je tourne mon regard en direction de mes pieds sans intention particulière implique une affection du corps et une idée de cette affection, mais ne constitue pas pour autant un affect, car ce geste est sans effet sur ma puissance d'agir. Cet exemple, toutefois, montre que la frontière entre l'affection et l'affect est ténue, car il suffit que j'accomplisse le même geste intentionnellement en vue de me retirer une écharde du pied, pour qu'il augmente ma puissance d'agir et se transforme ipso facto en affect. Dans ces conditions, il est possible de se demander si, en fin de compte chez Spinoza, toute affection n'est pas susceptible de devenir un affect. Le cas de l'admiration est éclairant à cet égard, car, si elle est présentée comme une simple affection, elle peut néanmoins donner naissance à des affects et entrer dans leur composition. L'affect de dévotion, par exemple, se définit comme "l'amour pour celui que nous admirons" <Ethique, III, déf. des affects, X>. Il y a donc passage de l'affection à l'affect, de sorte que la frontière entre les deux n'est pas tranchée de manière radicale et absolue. Il arrive même que Spinoza assimile indirectement les deux, puisqu'il définit non seulement l'affection, mais également l'affect comme un état (constitutio). Au cours de la démonstration de la proposition XVIII de l'Ethique III, il est en effet question de "l'état du corps ou affect" (corporis constitutio, seu affectus), comme le fait remarquer Jean-Marie Beyssade." (L'unité du corps et de l'esprit, p.89) "Toutefois, en attendant d'être connue adéquatement ou utilisée à des fins profitables ou nuisibles, une affection est un affect si et seulement si elle a un impact sur la puissance d'agir du corps. Le concept central qui permet de délimiter la nature et la sphère d'extension de l'affect est celui de la potentia agendi du corps. L'affect n'a pas d'existence absolue et indépendante de la puissance d'agir ; il n'est pas simplement relatif à une cause et à ses effets, mais il qualifie un type d'effets particuliers" (id p.90) "Mens se ipsam non cognoscit nisi quatenus corporis affectionum ideas percipit." "L'esprit ne se connaît lui-même qu'en tant qu'il perçoit les idées des affections du corps." (Ethique, II, 23) "Ces affections qui le déterminent à agir sont premières et sans elles nulle conscience n'est possible. Si la conscience accompagne nécessairement l'affect actif, elle est plus vacillante dans l'affect passif, car l'homme perçoit son appétit, mais ignore les causes qui le déterminent à agir. D'un point de vue mental, l'affect enveloppe donc plus ou moins de conscience en fonction de son caractère plus ou moins passif. (...) Il ne se définit pas cependant par rapport à cette conscience, puisque le désir au sens large englobe tous les efforts, impulsions, appétits et volitions de l'homme." (L'unité du corps et de l'esprit, p.116)
Affection et corps : "L'idée d'une quelconque manière dont le Corps humain est affecté par les corps extérieurs doit envelopper la nature du Corps humain, et en même temps la nature du corps extérieur." (II, 16 trad. Pautrat) "En effet, toutes les manières dont un corps est affecté suivent de la nature du corps affecté, et en même temps de la nature du corps qui affecte : et donc leur idée enveloppera nécessairement la nature de l'un et de l'autre corps ; et par suite l'idée d'une quelconque manière dont le Corps humain est affecté par un corps extérieur enveloppe la nature du Corps humain, et celle du corps extérieur. CQFD" (id démonstration) "De là suit, premièrement, que l'Esprit humain perçoit la nature d'un très grand nombre de corps en même temps que la nature de son corps." (id corollaire 1) "Il suit, deuxièmement, que les idées que nous avons des corps extérieurs indiquent plus l'état de notre corps que la nature des corps extérieurs (...)" (id corollaire 2) "L'Esprit humain ne connaît le corps humain lui-même, et ne sait qu'il existe, qu'à travers les idées des affections dont le corps est affecté." (II, 19, trad. Pautrat) "L'esprit peut faire que toutes les affections du corps –autrement dit les images des choses- soient rapportées à l'idée de Dieu" (V, 14)
Affects primitifs : Désir, Joie et Tristesse.
Affectus / affectio : "Chez Spinoza il y a trois dimensions : l'essence elle-même, éternelle; il y a les affections de l'essence ici et maintenant qui sont comme autant d'instants, à savoir ce qui m'affecte en ce moment, et puis il se trouve que Spinoza distingue avec beaucoup de rigueur affectio et affectus. Affectio c'est l'affection, mais affectus ce n'est pas le sentiment. Il faut traduire affectus par affect. Spinoza distingue bien l'affection et l'affect. Qu'est-ce que c'est que l'affect ? Spinoza nous dit que c'est quelque chose que l'affection enveloppe. L'affection enveloppe un affect. L'affection c'est l'effet instantané d'une image de chose sur moi. Par exemple les perceptions sont des affections. L'image de chose associée à mon action est une affection. L'affection enveloppe, implique : au sein de l'affection il y a un affect. Et pourtant il y a une différence de nature entre l'affect et l'affection. Qu'est-ce que mon affection, c'est à dire l'image de chose et l'effet de cette image sur moi, qu'est-ce qu'elle enveloppe ? Elle enveloppe un passage, un passage ou une transition, mais il faut le prendre dans un sens très fort. C'est autre chose qu'une comparaison de l'esprit. Ce n'est pas une comparaison de l'esprit entre deux états, c'est un passage ou une transition enveloppée par toute affection. Toute affection instantanée enveloppe un passage ou une transition. Qu'est-ce que c'est ce passage, cette transition ? Ce n'est pas du tout une comparaison de l'esprit, donc c'est un passage vécu ou une transition vécue, ce qui ne veut pas dire forcément consciente. Tout état implique un passage ou une transition vécue. Passage de quoi à quoi, entre quoi et quoi ? Si rapprochés que soient les deux moments du temps, les deux instants que je considère instant a et instant a', il y a un passage de l'état antérieur à l'état actuel. Le passage de l'état antérieur à l'état actuel diffère en nature de l'état antérieur et de l'état actuel. Il y a une spécificité de la transition et c'est précisément ça que Spinoza appelle durée. La durée c'est le passage vécu, le passage d'une chose à une autre, en tant que vécue." (...) "Le passage est irréductible aux deux états et c'est ça que toute affection enveloppe. Je dirais que toute affection enveloppe le passage par lequel on arrive à elle, et par lequel on sort d'elle, vers une autre affection, si proches soient les deux affections considérées. Donc je vais avoir ma ligne complète, c'est une ligne à trois temps : a, a', a"; a c'est l'affection instantanée, l'affection du moment présent; a' c'est celle de tout à l'heure, et a" c'est celle d'après, celle à venir. J'ai beau les rapprocher au maximum, il y a toujours quelque chose qui les sépare, à savoir le phénomène du passage. Ce phénomène du passage en tant que phénomène vécu c'est la durée. C'est ça la troisième appartenance de l'essence. J'ai une définition un peu plus stricte de l'affect. L'affect ou ce que toute affection enveloppe et qui, pourtant est d'une autre nature, c'est le passage, c'est la transition vécue de l'état précédent à l'état actuel ou de l'état actuel à l'état suivant. On fait une espèce de décomposition des trois appartenances de l'essence. L'essence appartient à elle-même sous la forme de l'éternité, l'affection appartient à l'essence sous la forme de l'instantanéité, l'affect appartient à l'essence sous la forme de la durée. Or le passage, c'est quoi ? Il faut sortir de l'idée spatiale. Tout passage, nous dit Spinoza, et ça va être la base de sa théorie de l'affect, tout passage est, il ne dira pas le mot implique. Comprenez qu'à ce niveau les mots sont très importants. Il nous dira de l'affection qu'elle implique un affect, mais justement l'enveloppé et l'enveloppant n'ont pas la même nature. Toute affection, c'est à dire tout état déterminable à un moment, enveloppe un affect, un passage. En quoi consiste ce passage ? Qu'est-ce qu'il est ? La réponse de Spinoza : il est augmentation ou diminution de ma puissance, même infinitésimale. " (...) "Je ne dirais pas que les affects signalent des diminutions et des augmentations de puissance, je dirais que les affects sont les diminutions et les augmentations de puissance vécues et pas forcément conscientes. C'est une conception très très profonde de l'affect. Donnons leur des noms pour mieux nous repérer. Les affects qui sont des augmentations de puissance on les appellera des joies; les affects qui sont de diminutions de puissance, on les appellera des tristesses. Les affects sont ou bien à base de joie ou bien à base de tristesse. La tristesse c'est l'affect qui correspond à une diminution de puissance, la joie c'est l'affect qui correspond à une augmentation de puissance." (...) "qu'il y a une sphère d'appartenance de l'essence. Cette sphère d'appartenance comporte, pour le moment, trois dimensions. L'essence est éternelle. Votre essence singulière, votre essence à vous en particulier. Vous êtes un degré de puissance, c'est la formule. C'est ça que Spinoza veut dire lorsqu'il dit, textuellement, "je suis une partie de la puissance de Dieu". Ça veut dire que je suis un degré de puissance. Ce degré de puissance pourra varier. Il a une latitude. Je suis un degré de puissance et c'est en ce sens que je suis éternel. Personne n'a le même degré de puissance qu'un autre. C'est une conception quantitative de l'individuation, mais c'est une quantité spéciale puisque c'est une quantité de puissance. Une quantité de puissance, on a toujours appelé cela une intensité. C'est à cela uniquement que Spinoza affecte le terme éternité. Je suis un degré de la puissance de Dieu, ça veut dire que je suis éternel. Deuxième sphère d'appartenance : j'ai des affections instantanées. C'est la dimension de l'instantanéité. Suivant cette dimension les rapports se composent ou ne se composent pas. C'est la dimension de l'affectio. Composition ou décomposition entre les choses. Troisième dimension de l'appartenance. Les affects, à savoir chaque fois qu'une affection effectue ma puissance, et elle l'effectue aussi parfaitement qu'elle le peut, aussi parfaitement que c'est possible, l'affection effectue ou réalise ma puissance. Elle réalise ma puissance aussi parfaitement qu'elle le peut en fonction des circonstances, en fonction du ici maintenant. Elle effectue ma puissance ici maintenant en fonction des choses. La troisième dimension c'est que, chaque fois qu'une affection effectue ma puissance, elle ne l'effectue pas sans que ma puissance augmente ou diminue. C'est la sphère de l'affect. Donc ma puissance est un degré éternel, cela n'empêche pas que, dans la durée, elle ne cesse pas d'augmenter et de diminuer. Cette même puissance qui est éternelle en soi ne cesse d'augmenter, de diminuer, c'est à dire de varier dans la durée." (...) "Les affects de diminution ou d'augmentation de puissance, là Spinoza est formel, ce sont des passions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme dans toute la terminologie du 17ème siècle, passion est un mot très simple qui s'oppose à action. Passion c'est le contraire d'action. Donc les affects d'augmentation de puissance, c'est à dire les joies, ne sont pas moins des passions que les tristesses" (...) "Il y a donc deux sortes d'affects de les joies-passion et les joies-action. Les joies-passion sont toutes celles qui se définissent par l'augmentation de la puissance d'agir, les joies-action sont toutes celles qui se définissent comme découlant d'un puissance d'agir possédée. " (Deleuze, Cours à l'université de Vincennes, 20/01/1981) "Le pouvoir d'être affecté d'une essence peut aussi bien être réalisé par des affections externes que par des affections internes. Il ne faut surtout pas penser que pouvoir d'être affecté renvoie plus à une infériorité que ne le faisait le rapport cinétique. Les affects peuvent être absolument externes, c'est le cas des passions. Les passions sont des affects qui remplissent le pouvoir d'être affectés et qui viennent du dehors. ... le livre 5 me paraît fonder cette notion d'auto-affection. Prenez un texte comme celui-ci : l'amour par lequel j'aime Dieu (sous-entendu au troisième genre) est l'amour par lequel Dieu s'aime lui-même et m'aime moi. Ça veut dire que , tous les degrés de puissance sont intérieurs les uns aux autres et intérieurs à la puissance dite puissance divine. Il y a une intériorité au niveau du troisième genre, toutes les essences sont intérieures les unes aux autres des essences et ça ne veut pas dire qu'elles se confondent. On arrive à un système de distinctions intrinsèques; dès lors qu'une essence m'affecte - et c'est ça la définition du troisième genre, une essence affecte mon essence -, mais comme toutes les essences sont intérieures les unes aux autres, une essence qui m'affecte c'est une manière sous laquelle mon essence s'affecte elle-même. " (id 24/03/1981) "que nous entendons ici par affections ce que Descartes a ailleurs désigné par attributs (dans la partie I des Principes, article 52). Car l'Être, en tant qu'il est un être, ne nous affecte pas par lui-même, comme substance; il faut donc l'expliquer par quelque attribut sans qu'il s'en distingue autrement que par une distinction de Raison. Je ne peux donc assez m'étonner (p. 344) de l'excessive subtilité d'esprit de ceux qui ont cherché, non sans grand dommage pour la vérité, un intermédiaire entre l'Être et le Néant. Mais je ne m'arrêterai pas à réfuter leur erreur, puisque eux-mêmes, quand ils essaient de donner des définitions de telles affections, se volatilisent entièrement dans leur propre vaine subtilité. Définition des affections. – Nous poursuivrons donc notre affaire en disant que les affections de l'Être sont certains attributs sous lesquels nous connaissons l'essence ou l'existence de chaque être, de laquelle cependant il ne se distingue que par une distinction de Raison." (Pensées Métaphysiques, chap.3, p.344-345) "Les affects sont ainsi les noms des constantes fluctuations, en plus ou en moins, de notre puissance." (C. Ramond, Le Vocabulaire de Spinoza, p.11) Alquié traduit par "sentiment" le terme : affectus. "...qu'il ne faut pas confondre avec les "affections", le terme "affection" renvoyant le plus souvent, chez Spinoza, aux affections de la Substance, et donc aux modes. En un sens plus restreint, le mot : affectio désigne les modifications que reçoit, au cours de sa vie, le corps humain. C'est pourquoi Spinoza, distinguant, en une même phrase, affectus et affectio, peut écrire : "J'entends par sentiments les affections du corps par lesquelles la puissance de ce corps est accrue ou diminuée, secondée ou réduite, et en même temps les idées de ces affections (per affectus intelligo corporis affectiones, quibus ipsius corporis agendi potentia augetur vel minuitur, juvatur vel coercetur, et simul harum affectionum ideas.<Eth. III, déf. 3>)" (Le Ratio. de Spinoza, p.282) "...les affections sont des manières (par le Post. 3) par lesquelles les parties du Corps humain, et par conséquent le Corps humain tout entier est affecté." (Ethique, II, 28 dém. trad. Pautrat) "...les affections d'un mode se disent en fonction d'un certain pouvoir d'être affecté. Un cheval, un poisson, un homme, ou même deux hommes comparés l'un avec l'autre, n'ont pas le même pouvoir d'être affectés par la même chose de la même façon. Un mode cesse d'exister quand il ne peut plus maintenir entre ses parties le rapport qui le caractérise ; de même, il cesse d'exister quand "il n'est plus apte à pouvoir être affecté d'un grand nombre de façons" <E, IV, 39 dém.>" (Spinoza et le Pb... p.197) "Différents hommes peuvent être affectés de façon différente par un seul et même objet, et le même homme peut aussi être affecté par un seul et même objet de façon différente dans des temps différents." (Ethique, III, 51, trad. Saisset) "Quelle est la structure (fabriaca) d'un corps? Qu'est-ce que peut un corps? La structure d'un corps, c'est la composition de son rapport. Ce que peut un corps, c'est la nature et les limites de son pouvoir d'être affecté." (Spinoza et le Pb... p.198) "...il n' y a pas de causes extérieures à Dieu ; Dieu est nécessairement cause de toutes ses affections, toutes ses affections s'expliquent par sa nature, donc sont des actions. Il n'en est pas de même des modes existants. Ceux-ci n'existent pas en vertu de leur propre nature ; leur existence est composée de parties extensives qui sont déterminées et affectées du dehors, à l'infini. Il est donc forcé que chaque mode existant soit affecté par des modes extérieurs, qu'il subisse des changements qui ne s'expliquent pas par sa seule nature. Ses affections sont d'abord et avant tout des passions. Spinoza remarque qui l'enfance est un état misérable, mais un état commun où nous dépendons "au plus haut degré des causes extérieures" <E, V, 6 sc. et 39 sc.>. La grande question qui se pose à propos du mode existant fini est donc : Arrivera-t-il à des affections actives, et comment? Cette question est à proprement parler la question "ethique". Mais, même à supposer que le mode arrive à produire des affections actives, tant qu'il existe il ne supprimera pas en lui toute passion, mais fera seulement que ses passions n'occupent plus qu'une petite partie de lui-même. <cf. E. V, 20>. Une dernière différence concerne le contenu même du mot "affection", suivant qu'on le rapporte à Dieu ou aux modes. Car les affections de Dieu sont les modes eux-mêmes, essences de modes ou modes existants. Leurs idées expriment l'essence de Dieu comme cause. Mais les affections des modes sont comme des affections au second degré, des affections d'affections : par exemple, une affection passive que nous éprouvons n'est que l'effet d'un corps sur le nôtre. L'idée de cette affection n'exprime pas la cause, c'est-à-dire la nature ou l'essence du corps extérieur : elle indique plutôt la constitution présente de notre corps, donc la manière dont notre pouvoir d'être affecté se trouve rempli à tel moment. L'affection de notre corps est seulement une image corporelle, et l'idée d'affection telle qu'elle est dans notre esprit, une idée inadéquate ou une imagination. Nous avons encore une autre espèce d'affections. D'une idée d'affection qui nous est donnée découlent nécessairement des "affects" ou sentiments (affectus) <cf. CT, appendice II, 7 et E, II, axiome 3>. Ces sentiments sont eux-mêmes des affections, (199) ou plutôt des idées d'affections de nature originale. " (id p.199-200) "En fait, une idée qui nous avons indique l'état actuel de la constitution de notre corps ; tant que notre corps existe, il dure et se définit par la durée ; son état actuel n'est donc pas séparable d'un état précédent avec lequel il s'enchaîne dans une durée continue. C'est pourquoi, à toute idée qui indique un état de notre corps est nécessairement liée une autre espèce d'idée qui enveloppe le rapport de cet état avec l'état passé. Spinoza précise : on ne croira pas qu'il s'agit d'une opération intellectuelle abstraite, par laquelle l'esprit comparerait deux états. Nos sentiments, par eux-mêmes, sont des idées qui enveloppent le rapport concret du présent avec le passé dans une durée continue : ils enveloppent les variations d'un mode existant qui dure. Les affections données d'un mode sont donc de deux sortes : états du corps ou idées qui indiquent ces états, variations du corps ou idées qui enveloppent ces variations. Les secondes s'enchaînent avec les premières, varient en même temps qu'elles : on devine comment, à partir d'une première affection, nos sentiments s'enchaînent avec nos idées, de manière à remplir à chaque instant tout notre pouvoir d'être affecté." (id p.200) "Je n'entends pas que l'esprit compare la présente constitution du corps avec une passée, mais que l'idée qui constitue la forme de l'affect affirme du corps quelque chose qui enveloppe à la vérité plus ou moins de réalité qu'auparavant." (*Ethique, III déf. générale des affects) "Le lien des deux <idées inadéquates et sentiments passifs> est bien marqué par Spinoza : l'idée inadéquate est une idée dont nous ne sommes pas cause (elle ne s'explique pas formellement par notre puissance de comprendre) ; cette idée inadéquate est elle-même cause (matérielle et efficiente) d'un sentiment ; nous ne pouvons donc pas être cause adéquate de ce sentiment ; or un sentiment dont nous ne sommes pas cause adéquate est nécessairement une passion" (Spinoza et le Pb... pp.200-201) "...un sentiment dont nous sommes cause adéquate est une action. C'est en ce sens que Spinoza peut dire : "Dans la mesure où il a des idées adéquates, il est nécessairement actif en certaines choses, et dans la mesure où il a des idées inadéquates, il est nécessairement passif en certaines choses." (...) "Dès lors, la question proprement éthique se trouve liée à la question méthodologique : Comment arriverons-nous à être actifs? Comment arriverons-nous à produire des idées adéquates? (id p.201) "...tant que son pouvoir d'être affecté se trouve rempli par des affections passives, ce pouvoir lui-même se présente comme une force ou puissance de pâtir. On appelle puissance de pâtir le pouvoir d'être affecté, en tant qu'il se trouve actuellement rempli par des affections passives. La puissance de pâtir du corps a pour équivalent dans l'âme la puissance d'imaginer et d'éprouver des sentiments passifs." (id p.201) "La puissance de comprendre ou de connaître est la puissance d'agir propre à l'âme. Mais, précisément, le pouvoir d'être affecté reste constant, quelle que soit la proportion des affections passives et affections actives. Nous arrivons donc à l'hypothèse suivante : La proportion des affections passives et actives serait susceptible de varier, pour un même pouvoir d'être affecté. Si nous arrivons à produire des affections actives, nos affections passives diminuent d'autant." (id p.202) Pouvoir d'être affecté = aptitude d'un corps aussi bien à pâtir qu'à agir. cf *Ethique II, 13 : "plus un corps est apte, par rapport aux autres, à agir et à pâtir de plus de façons à la fois..." / mais plus loin Deleuze dit "...le pouvoir d'être affecté ne reste pas constant toujours, ni sous tous les points de vue. En effet, Spinoza suggère que le rapport qui caractérise un mode existant dans son ensemble est doué d'une sorte d'élasticité." (...) "Croissance, vieillissement, maladie : nous avons peine à reconnaître un même individu. Et encore, est-ce bien ce même individu?" (Spinoza et le Pb... p.202) "...la puissance de pâtir n'exprime rien de positif. Dans toute affection passive, il y a quelque chose d'imaginaire qui l'empêche d'être réelle. Nous ne sommes passifs et passionnés qu'en raison de notre imperfection même. "Car il est certain que l'agent agit par ce qu'il a, et que le patient pâtit par ce qu'il n'a pas" ; "le pâtir, dans lequel l'agent et le patient sont distinct, est une imperfection palpable." <CT II, ch.26 et I, ch.2, 23> (...) "Mais notre force de pâtir est seulement l'imperfection, la finitude ou la limitation de notre force d'agir en elle-même. Notre force de pâtir n'affirme rien, parce qu'elle n'exprime rien du tout : elle "enveloppe" seulement notre impuissance, c'est-à-dire la limitation de notre puissance d'agir. En vérité, notre puissance de pâtir est notre impuissance, notre servitude, c'est-à-dire le plus bas degré de notre puissance d'agir" (...) "la puissance d'agir est la seule forme réelle, positive et affirmative d'un pouvoir d'être affecté. Tant que notre pouvoir d'être affecté se trouve rempli par des affections passives, il est réduit à son minimum, et manifeste seulement notre finitude ou notre limitation." (id p.204) "Il n'est aucune affection du corps dont nous ne puissions former quelque concept clair et distinct" (ETHIQUE, V, 4) Au coeur de nos affections, "il y a une différence entre ce par quoi nous exprimons notre puissance et ce par quoi nous sommes impuissant. Jamais, certes, une affection, quelle qu'elle soit, ni le sentiment auquel elle donnera lieu, ne seront le principe d'une idée adéquate ni, par conséquent, d'une activité. Mais elle pourra, en tant qu'elle augmentera notre puissance d'agir, favoriser la naissance de telles idées dans le prolongement d'une passion joyeuse. " (Fraisse, L'oeuvre de Spinoza, p.178) "Le caractère novateur de la théorie spinoziste se manifeste d'abord au niveau du vocabulaire par la substitution du mot affectus à celui d'emotio ou de passio, pour désigner les mouvements affectifs de l'homme. Chez Spinoza, ce n'est plus le concept d'émotion qui est central, mais celui d'affect." (Jaquet, L'Unité du corps et de l'esprit, p.67) "...le terme affectus figure déjà chez Descartes et désigne la passion ou l'émotion dans sa double dimension psychophysiologique. C'est ce qui ressort du texte latin des Principes de la Philosophie, notamment du § 190 dans lequel Descartes traite des affects de l'âme (animi affectibus) ainsi que les appétits naturels et assimile une première fois émotion, passion et affect <Principiorum philosophiae, pars quarta, 190, A.T, VII, p.316 "...in quo consistunt omnes animi commotiones, sive pathemata, et affectus">, puis une seconde fois affect et passion <ibid, p.317 "...quatenus sunt tantum, affectus, sive animi pathemata.">. D'autre part, le concept d'émotion, quoique rare, est présent chez Spinoza, et il est synonyme de celui d'affect. Ainsi, dans la partie IV de l'Ethique, il est dit que "la vraie connaissance du bien et du mal excite les émotions de l'âme" (animi commotiones) (L'unité du corps et de l'esprit, p.67) (...) "...il est clair que les deux termes renvoient l'un à l'autre et se recouvrent. Spinoza lui-même corrobore cette conclusion en assimilant à plusieurs reprises les affects aux émotions, dans la proposition II de l'Ethique V, où il se réfère à "une émotion de l'âme, autrement dit un affect" (animi commotionem, seu affectum) ; dans le scolie de la proposition XX de l'Ethique V, où il soutient que, "quand nous comparons entre eux les affects d'un seul et même homme et que nous le trouvons plus affecté ou ému (affecti sive moveri) par l'un que par l'autre" ; dans le Traité politique, I, IV, où il affirme avoir "considéré les affects humains (humanos affectus) comme l'amour, la haine, la colère, la jalousie, la gloire, la miséricorde, et le reste des émotions de l'âme (animi commotiones)- non comme des vices de la nature humaine, mais comme des propriétés qui lui appartiennent au même titre que le chaud et le froid..."." (L'unité du corps et de l'esprit, p.68) Spinoza enrichit la notion d'affect . / "Traditionnellement, en effet, adfectus désignait chez les philosophes avant tout une disposition, un état de l'âme, notamment chez Cicéron dans les Tuscalanes <V, 47 : "Or, l'état (adfectus) de l'âme chez un homme est un bien louable">. Il était pris comme synonyme de "sentiment", ou de "passion" <cf Ovide, Métamorphoses, VIII, 473 : "Elle erre entre deux sentiments" (dubis affectibus errat)>. Par ailleurs, il était aussi employé en médecine pour désigner une disposition du corps, une affection, une maladie. Spinoza ressaisit les deux acceptions de ce terme sous l'unité d'un concept qui comprenne à la fois une affection corporelle et une modification mentale." (L'unité du corps et de l'esprit, p.68) "L'affect envisagé dans sa réalité mentale englobe aussi bien les idées confuses que les idées adéquates. Il n'est pas d'emblée assimilé à une idée confuse, comme ce sera le cas dans la définition générale des affects où il s'agit exclusivement des passions." (...) "En tant qu'il unit une affection corporelle et une affection mentale qui modifient la puissance d'agir, le concept d'affectus chez Spinoza possède donc une signification qui ne recouvre pas exactement les acceptions traditionnelles du terme "passion"."(id p.69) "La différence entre action et passion repose en effet sur la nature adéquate ou inadéquate de la cause qui produit l'affection (...) La partition des affects en deux genres et donc fondée sur un mode du penser –à savoir, le caractère adéquat ou inadéquat de la cause. Quand bien même les concepts d'action et de passion s'appliquent au corps, il n'en demeure pas moins que le critère qui les différencie est avant tout intellectuel et présuppose une aptitude de l'esprit à concevoir la cause, d'une part, et à vérifier si son effet est intelligible par elle seule, d'autre part, et à vérifier si son effet est intelligible par elle seule, d'autre part. Loin de corroborer l'idée d'un primat radical du corps au sein de la définition III, la distinction entre (84) actions et passions relève de l'attribut pensée, car elle implique la possibilité de percevoir clairement et distinctement l'effet comme totalement ou partiellement contenu dans la cause." (id pp.84-85) Est affect 1°)ce qui augmente la puissance d'agir du corps 2°) ce qui la diminue 3°) "Est affect en troisième lieu une affection qui aide (juvatur) la puissance d'agir. Le verbe juvare peut se traduire par "aider", "seconder", "assister" et renvoie à l'idée d'une cause adjuvante favorable à la puissance d'agir. <4°)> Est un affect en dernier lieu une affection qui contrarie (coercetur) la puissance d'agir. Le verbe coercere, qui signifie "enfermer", "contenir", "réprimer", suggère l'idée d'une contrainte et sous (94) entend l'existence d'une cause d'empêchement qui bride la puissance d'agir et la maintient dans des limites. Coercere est également le terme que Spinoza emploie pour qualifier l'activité de la raison en tant qu'elle s'oppose aux affects. L'Ethique V se propose ainsi de déterminer la puissance de la raison et de "montrer de quelle force et de quelle nature est l'empire qu'elle a pour contrarier et modérer (coërcendum et moderandum) les affects". <Ethique, V, préface>" (L'unité du corps et de l'esprit, pp.94-95) Les affects sont des états de transition de la puissance (potentia agendi). Il y aurait, suivant Jaquet, "quatre types de modifications de la puissance d'agir" (id p.99) : augmentation, diminution, aide et "contrariance"(j'invente l'expression). A quoi renvoient ces affects ne diminuant ni n'augmentant la puissance d'agir? Ils sont des affects par association d'idée, d'où ce statut intermédiaire "...la proposition XV de l'Ethique III qui examine le cas de "l'esprit affecté par deux affects à la fois, l'un qui n'augmente ni ne diminue sa puissance d'agir, et l'autre qui l'augmente ou la diminue". Lorsque, ultérieurement, l'esprit "viendra à être affecté du premier et par sa véritable cause, laquelle (par hypothèse) par elle-même n'augmente ni ne diminue sa puissance de penser, il sera aussitôt affecté aussi de l'autre, qui aug- (p.99) mente ou bien diminue sa puissance de penser, c'est-à-dire (par le Scol. Prop.11 de cette partie) de joie ou de tristesse ; et par suite cette chose sera non par soi, mais par accident cause de joie ou bien de tristesse"." (id pp.99-100) L'unique arme contre un affect : lui-même : "Affectus nec coerceri nec tolli potest nisi per affectum contrarium et fortiorem affectu coercendo." "Un affect ne peut être contrarié ni supprimé que par un affect contraire et plus fort que l'affect à contrarier." (Ethique, IV, 7, trad.Pautrat) "Est namque affectus corporis affectionis idea (per generalem affectuum definitionem) quæ propterea (per propositionem præcedentem) aliquem clarum et distinctum involvere debet conceptum." "Car l'affect est l'idée d'une affection du Corps (par la Défin. génér. des Aff.), et pour cette raison (par la Prop. précéd.) il doit envelopper un concept clair et distinct." (Ethique, V, 4 corollaire trad. Pautrat) "Certes, cette formule prise à la lettre n'identifie pas l'affect à la conscience, mais à l'idée d'une affection corporelle, qu'elle soit adéquate ou inadéquate. Toutefois, ce glissement de la connaissance à la conscience n'est pas illégitime, car Spinoza assimile expressément les deux au cours de la démonstration de la proposition IX de l'Ethique III." (L'unité du corps et de l'esprit, p.113) : ce point est discutable... / "...à tout affect du corps, correspond une idée, et qu'à tout affect de l'esprit, une détermination du corps. Tout comme l'affection, l'affect peut donner lieu à trois types de discours : psychophysique, psychique, physique, selon qu'il (118) est rapporté à la fois à l'esprit et au corps, à l'esprit seul, ou au corps seul." (id. p.118-119) "Dieu est exempt de passions, et nul affect de Joie ou de Tristesse ne l'affecte." (Ethique, V, 17 trad. Pautrat)
Ambition : "L'ambition est le désir immodéré de la gloire" (III, définition 44 des sentiments) "L'ambition est le désir par lequel tous les sentiments (…) sont favorisés et fortifiés ; aussi ce sentiment peut-il être à peine dominé. Car, aussi longtemps qu'un homme est possédé de quelque désir, il est aussi nécessairement possédé de celui-ci. Le meilleur, dit Cicéron, est encore conduit par la gloire. Même les philosophes signent de leur nom les livres qu'ils écrivent sur le mépris et la gloire, etc."<Cicéron, Pro Archia, II> (Explication de supra)
Ame : "L'âme n'est pour Spinoza qu'un mode fini qui ne s'explique que par l'attribut de la pensée infinie. L'esprit humain ne peut se comprendre que par la pensée totale qui le dépasse comme individu particulier, ce n'est donc rien d'autre qu'une idée, l'idée d'un corps existant en acte. L'homme n'est pas un mixte de matière (24) et d'esprit, il est foncièrement un, mais son être s'exprime par son corps ou par ses idées ; la modification de l'étendue qu'est notre corps correspond à la modification de la pensée qui est idée de ce corps, connaissance de ce qui arrive au corps." "L'étendue n'est donc plus totalement hétérogène à la pensée, puisque l'un et l'autre expriment le même être infini." (Intro Caillois p.24-25) "L'homme n'est plus union de l'âme et du corps, mais partie de l'univers homogène, partie qui a sa structure singulière. Aussi Spinoza ne sépare-t-il jamais l'esprit du corps. En tant qu'idée du corps l'esprit (ou âme) meurt avec lui. Ainsi s'achève l'unité temporelle de l'homme par la disparition du corps et de son idée" (ibid p.26) "…la force de l'âme, c'est-à-dire à la fermeté et à la générosité." (IV, scolie de la prop. 73) "nous n'avons rien dit du temps de la création de l'âme humaine, parce qu'on ne peut établir en quel temps Dieu la crée, puisqu'elle peut exister sans le corps. Ce qui est certain c'est qu'elle ne provient pas d'un intermédiaire, car cela a lieu seulement dans les choses qui sont engendrées, tels les modes d'une substance; tandis que la substance même ne peut être engendrée mais seulement créée par le seul Etre Omnipotent, comme nous l'avons démontré précédemment." (Pensées Métaphysiques, partie 2, Chap.12, p.385) "L'âme n'assure plus le lien entre les parties du corps, elle n'est pas non plus le maître (ni l'esclave) du corps : elle en est l'idée, c'est-à-dire le strict équivalent, sur le plan de la pensée, de ce qu'est le corps sur le plan de l'étendue (II, 21). C'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le "parallélisme", bien que le terme ne se trouve pas chez Spinoza." (C.Ramond, Le Vocabulaire de Spinoza, p.16) Le mot est rarement utilisé dans l'Ethique. "Spinoza y substitue le mot mens –esprit. C'est que âme, trop chargée de préjugés théologiques, ne rend pas compte : 1° de la vraie nature de l'esprit, qui est d'être une idée, et l'idée de quelque chose ; 2° du vrai rapport avec le corps, qui est précisément l'objet de cette idée ; 3° de la véritable éternité dans sa différence de nature avec la pseudo - immortalité ; 4° de la composition pluraliste de l'esprit, comme idée composée qui possède autant de parties que de facultés." (Spinoza Philo. Prat. p.92) "L'essence de l'âme consiste donc uniquement en ce qu'elle est dans l'attribut pensant une idée ou une essence objective qui naît de l'essence d'un objet existant réellement dans la Nature." (Court Traité, Appendice, §9 p.164)
Amitié : "Il est avant tout utile aux hommes de nouer des relations entre eux, de se forger ces liens qui les rendent plus aptes à constituer tous ensemble un seul tout, et de faire sans restriction ce qui contribue à affermir les amitiés." (IV, chap.XII de l'appendice)
Amor Dei intellectualis : "Du troisième genre de connaissance naît nécessairement un Amour intellectuel de Dieu. Car de ce genre de connaissance naît une joie qu'accompagne l'idée de Dieu comme cause, c'est-à-dire un Amour de Dieu, non pas en tant que nous l'imaginons comme présent, mais en tant que nous comprenons que Dieu est éternel , et c'est là ce que j'appelle Amour intellectuel de Dieu." (V, 32 corollaire, trad. Pautrat) "L'amour intellectuel de Dieu, qui naît du troisième genre de connaissance, est éternel." (V, 33) "Dieu s'aime lui-même d'un amour intellectuel infini." "Deus se ipsum amore intellectuali infinito amat" (V, 35) "L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu, dont Dieu s'aime lui-même, non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut être expliqué par l'essence de l'esprit humain considéré sous l'espèce de l'éternité ; c'est-à-dire que l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est une partie de l'amour infini dont Dieu s'aime lui-même." (V, 36) "Sed amor erga rem aeternam, et infinitam sola laetitia pascit animum" "Mais l'amour d'une chose éternelle et infinie nourrit l'âme d'une joie pure" (Traité de la Réforme... §10) "De la connaissance du troisième genre qui nous fait apercevoir en Dieu l'éternité de notre être naît notre plus grand contentement intérieur, avec l'accompagnement, comme cause, de l'idée de nous-même et de l'idée de Dieu : cette joie est donc un amour, un amour intellectuel de Dieu." (Le Spinozisme, pp.164-165) pb. si l'amour est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure, comment Dieu, a qui rien n'est extérieur, pourrait-il aimer? La solution réside peut être dans cet ajout du terme amour intellectuel./ "le mot jadah signifie les deux" (T.T.P, IV, p.95) "...la connaissance intellectuelle, autrement dit exacte de Dieu" (T.T.P, XIII, p.231) Dissocier l'amour de Dieu de l'amor dei intellectualis : "La béatitude en tant qu'amour envers Dieu admet des transitions de la puissance d'agir, non seulement parce qu'elle cesse avec la mort, mais parce qu'elle est susceptible d'un accroissement proportionnel aux aptitudes corporelles et à la grandeur de la part éternelle de l'esprit. Ainsi, "plus l'esprit jouit de cet amour divin ou béatitude, plus il comprend, c'est-à-dire, plus grande est la puissance sur les affects, et moins il pâtit des affects qui sont mauvais. <Ethique, V, 42>". En revanche, l'amour intellectuel de Dieu en tant qu'il se rapporte à l'esprit seul ne met pas en jeu des affections du corps et ne semble pas susceptible de variations, car il ne se heurte à aucun affect mauvais." (L'unité du corps et de l'esprit, p.99)
Amour : "L'Amour, en effet, n'est rien d'autre que la Joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure" (III scolie de la prop. 13) "L'amour est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure." (III définition 6 des sentiments p.245) "L'amour sensuel (amor meretricius), c'est-à-dire le désir d'engendrer (generandi libido), qui naît de la forme belle, et en général tout amour qui reconnaît une autre cause que la liberté de l'âme, se change facilement en haine, à moins, ce qui est pire, qu'il ne soit une espèce de délire, et alors est favorisé la discorde plutôt que la concorde." (IV, chap.XIX de l'appendice) "amore non armis animi vincuntur" "...les âmes ne sont pas vaincues par les armes, mais par l'amour et la générosité" (Ethique, IV, appendice, chapitre XI) "Celui qui se comprend lui-même et comprend ses sentiments, clairement et distinctement, aime Dieu, et d'autant plus qu'il se comprend mieux lui-même et comprend mieux ses sentiments." (id, V, proposition 15) "Cet amour envers Dieu doit occuper l'esprit au plus haut degré." (id, V, 16) "...et comme nous voyons clairement qu'un amour est détruit par l'idée que nous pouvons acquérir d'une autre chose meilleure, il suit de là clairement qu'un amour est détruit par l'idée que nous pouvons acquérir d'une autre chose meilleure, il suit de là clairement que, si nous commençons une fois à connaître Dieu, du moins d'une connaissance aussi claire que celle que nous avons de notre corps, nous lui seront unis aussi plus étroitement qu'avec notre corps et serons détachés de ce dernier. Je dis Plus étroitement parce que j'ai déjà démontré que nous ne pouvons sans Dieu exister ni être conçus, et parce que nous le connaissons non par quelque chose d'autre (comme c'est le cas pour tous ce qui n'est pas lui), mais par lui-même et devons le connaître ainsi, comme nous l'avons déjà dit. On peut dire que nous le connaissons mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes, puisque sans lui nous ne pouvons aucunement nous connaître." (Court Traité, II, 19 §14, p.135) "...l'Ecriture elle-même enseigne aussi (240) avec la plus grande clarté ce que chacun est tenu d'accomplir pour obéir à Dieu ; elle enseigne, dis-je, que toute la loi consiste en ce seule commandement : aimer son prochain" (T.T.P, XIV, pp.240-241) cf. Epîtres aux Romains : "Rm 13 8- N'ayez de dettes envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. Rm 13 9- En effet, le précepte Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se résument en cette formule Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rm 13 10- La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la Loi dans sa plénitude." (Bible de Jérusalem) Appétit : "...les hommes se croient libres, pour la raison qu'ils ont conscience de leurs volitions et de leur appétit , et que, les causes qui les disposent à appéter et à vouloir, ils les ignorent, et n'y pensent pas même en rêve. Il suit, deuxièmement, qu'en tout les hommes agissent en vue d'une fin ; à savoir, à cause de l'utile dont ils ont l'appétit ; d'où vient que, des choses accomplies, ils veulent toujours savoir les causes finales, et rien qu'elles, et quant on les leur a dites, ils sont contents " (I, appendice, trad. Pautrat, p.81) Attribut : "Per attributum intelligo id quod intellectus de substantia percipit tanquam ejusdem essentiam constituens" "Par attribut, j'entends ce que l'entendement perçoit* de la substance comme constituant son essence." (I, Définition 4) par conséquent : "Plus une chose possède de réalité ou d'être, plus d'attributs lui appartiennent." (I Proposition 9) *mais ce n'est pas là affaire de point de vue : "...comme l'a montré surabondamment Martial Gueroult, une telle lecture est intenable dans le système : "ce que l'entendement perçoit", en effet, n'y est en aucune façon un "point de vue", mais la chose telle qu'elle est en elle-même. Les attributs sont donc, non pas pour nous mais en soi, l'essence de la substance." (C. Ramond, Le Vocabulaire de Spinoza, p.19) dans le cas de plusieurs attributs d'une même substance : "...chacun exprime la réalité ou l'être de la substance; Il n'est donc nullement absurde d'attribuer plusieurs attributs à une seule substance. Il n'est rien, au contraire, de plus clair dans la nature que ceci : chaque être doit être conçu sous quelque attribut, et plus il possède de réalité ou d'être, plus il possède d'attributs qui expriment et la nécessité, autrement dit l'éternité, et l'infinité ; et en conséquence, l'être absolument infini doit être nécessairement défini comme un être constitué par une infinité d'attributs, dont chacun exprime une certaine essence éternelle et infinie." (Ethique, I, 10, scolie) "...les attributs sont autant "d'expressions" distinctes d'une seule et même substance. C'est ce qu'on a appelé le "parallélisme" : les attributs sont autant d'expressions, sur des plans qui ne se recoupent jamais, d'une seule et même réalité, c'est-à-dire d'un seul et même "ordre", ou d'un seul et même enchaînement des causes"." (Le Vocabulaire de Spinoza, p.19) "...les attributs ne sont pas des "propriétés" qui seraient finalement distinctes de l'essence même de la Substance, celle-ci restant au fond inaccessible. Spinoza a dépassé cette théologie négative de l'inaccessible." (Misrahi, Le Corps et l'Esprit...p.48) "...l'entendement conçoit la véritable nature des choses, que les attributs existent en eux-mêmes et son séparés par une distinction réelle, qu'ils ne résultent pas du fait que l'entendement introduit artificiellement la diversité en une substance qui, en elle-même, serait une." (Le Rationalisme de Spinoza, p.111) "Les attributs nous font connaître Dieu et expliquent ce qu'il est. Ils ne sont pas des "adjectifs" qui, pour être compris, exigent un "substantif". Ils sont Dieu lui-même. "Par substance, écrit Spinoza à Simon de Vries <Lettre IX à Simon de Vries>, j'entends ce qui est en soi et est conçu par soi ; c'est-à-dire ce dont le concept n'implique pas le concept d'une autre chose. C'est la même chose que j'entends par attribut, à cela près que ce terme s'emploie du point de vue de l'entendement qui attribue à la substance telle nature déterminée." (Sylvain Zac, L'idée de Vie dans la Philosophie de Spinoza, p.17) "...nous dirons, d'un mot seulement, de ses attributs, que ceux qui nous sont connus consistent dans ces deux, la Pensée et l'Etendue." (Court Traité, I, 2, §28 p.57) "...il n'y a entre les attributs aucune sorte d'inégalité" (id, Appendice, §11 p.165) "L'attribut est l'essence de la substance, à la condition d'entendre par essence non plus la raison intrinsèque qui pose l'existence, mais, en un sens plus faible du mot, ce qu'il y a d'intelligible dans la substance, ce que l'esprit s'en représente." (Léon Brunschvicg, Spinoza et ses contemporains, Paris, P.U.F, 4e éd., 1951, p.40) "Or de Dieu qui est substance, peut-on dire que son concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose pour être formé? La définition de Dieu n'a-t-elle pas besoin au contraire du concept d'attribut puisqu'il est défini comme "consistant en une infinité d'attributs"." (...) "Le seul fait d'ailleurs que Dieu est défini est significatif. Car on ne peut définir que par rapport à d'autres concepts." (Kaplan, "Réflexions sur la définition de Dieu...", p.343)
Automate spirituel : "Nous avons montré cependant que l’idée vraie est simple, ou composée d’idées simples, telle l’idée faisant connaître comment et pourquoi une chose existe ou a eu lieu; nous avons montré aussi qu’il en découle dans l’âme des effets objectifs proportionnés à l’essence formelle de son objet; cela revient à ce qu’ont dit les anciens que la vraie science procède de la cause aux effets; à cela près cependant que, jamais que je sache, on n’a conçu, comme nous ici, l’âme agissant selon des lois déterminées et telle qu’un automate spirituel. " (T.R.E, trad Appuhn p.46) ""Automate spirituel" signifie d'abord qu'une idée, étant un mode de la pensée, ne trouve pas sa cause (efficiente et formelle) ailleurs que dans l'attribut pensée. (...) Voilà donc ce qui sépare Spinoza de la tradition antique : toute causalité efficiente ou formelle (à plus forte raison matérielle et finale) est exclue entre les idées et les choses, les choses et les idées." (Spinoza et le Problème... p.101)
Béatitude : "…la béatitude n'est rien d'autre que la satisfaction même de l'âme <animi acquiescentia >, qui naît de la connaissance intuitive de Dieu. Or parfaire l'entendement n'est également rien d'autre que comprendre Dieu, et les attributs de Dieu, et les actions qui suivent de la nécessité de sa nature. C'est pourquoi la fin dernière de l'homme qui est conduit par la Raison, c'est-à-dire le suprême désir, qui lui permet de régler tous les autres, est celui qui le porte à se concevoir de façon adéquate, lui-même et toutes les choses qui peuvent tomber sous son intelligence." (Ethique, IV, chapitre IV de l'appendice) "Ceci nous fait comprendre en quoi consiste notre salut (salus), autrement dit la Béatitude ou la Liberté : dans l'amour constant et éternel envers Dieu, autrement dit dans l'amour de Dieu envers les hommes." (id, V, 36, Scolie) "Le spinozisme est donc bien une éthique (comme le confirme le titre de l’œuvre principale), et non une épistémologie ou une théologie. Mais cette éthique n’est pas seulement une philosophie de la joie, elle est aussi une doctrine de la liberté : béatitude et liberté sont identiques (Éth. , V, 36, sc.) (...) C’est donc bien dans cette perspective éthique qu’il faut situer le spinozisme afin de comprendre que le système de la Nature est subordonné à ce projet existentiel d’une libre joie. La doctrine de la connaissance se comprendra et se situera selon le même principe : la connaissance adéquate n’est qu’un moyen ; c’est la liberté heureuse qui en est la fin suprême.* " (Robert Misrahi, Universalis, art. "Spinoza et spinozisme") *n.b : discutable , en tant que connaissance et liberté heureuse sont identique...(ici encore parenté avec Aristote) / "La béatitude c'est en même temps l'expérience de l'éternité" (...) "Pourquoi est-ce que dans la béatitude c'est toujours moi qui m'affecte ? C'est qu'à ce moment là, lorsque je possède ma puissance d'agir, j'ai tellement composé mes rapports, j'ai acquis une telle puissance dans la composition de mes rapports que j'ai composé mes rapports avec le monde entier, avec Dieu lui-même, c'est le stade ultime, que plus rien ne me vient du dehors. Ce qui me vient du dehors c'est aussi ce qui me vient du dedans, et inversement. Il n'y a plus de différence entre le dehors et le dedans, à ce moment là, tous les affects sont actifs. Le troisième genre de connaissance qui est l'éternité ou la béatitude, Spinoza le définira comme la coexistence intérieure de trois idées : l'idée de moi, l'idée du monde et l'idée de Dieu, mais telles que lorsque Dieu m'affecte, c'est moi qui m'affecte à travers Dieu. Et inversement lorsque j'aime Dieu c'est Dieu qui s'aime à travers moi. Il y a une espèce d'intériorité des trois éléments, de la béatitude : Dieu, le monde, et moi. Si bien que tous les affects sont actifs. Mais on reverra ça. "(Deleuze, Cours à l'université de Vincennes, 20/01/81) "...si le problème que se pose avant tout Descartes, c'est le problème de la certitude dans la science, le problème que se pose avant tout Spinoza, c'est le problème de la santé de l'âme, de la liberté vraie et de la béatitude." (Le Spinozisme, p.8) "Par là nous sommes amenés à la considération de la vie et de la personnalité de Spinoza, au rappel des circonstances qui lui fixèrent comme tâche la libre recherche d'une règle de conduite, à l'analyse de son genre d'esprit, et des intimes rapports qu'eut chez lui la curiosité intellectuelle avec le besoin de conquérir la plénitude de son existence et de réaliser la perfection de sa destinée." (id, pp.8-9) "Je ne cesse de me persuader toujours davantage que tous les évènements reflètent la puissance de l'Etre souverainement parfait et son vouloir immuable ; c'est à cette conviction, que je dois ma satisfaction la plus haute et la tranquillité de mon esprit." (Spinoza, Lettre XXI à Blyenbergh, Pléiade p.1146 ) "La Béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même; et nous n'en éprouvons pas de la joie (gaudemus) parce que nous réprimons <coercemus > nos penchants ; au contraire, c'est parce que nous en éprouvons de la joie que nous pouvons réprimer nos penchants." <Beatitudo non est virtutis præmium sed ipsa virtus nec eadem gaudemus quia libidines coercemus sed contra quia eadem gaudemus, ideo libidines coercere possumus>(Ethique, V, 42) "Il est donc, dans la vie, utile au premier chef de parfaire l'intellect, autrement dit la raison, autant que nous pouvons, et c'est en cela seul que consiste pour l'homme le souverain bien, autrement dit la béatitude ; car la béatitude n'est rien d'autre que la satisfaction même de l'âme qui naît de la connaissance intuitive de Dieu (...) Et donc, la fin ultime de l'homme que mène la raison, c'est-à-dire son plus haut Désir, par lequel il s'emploie à maîtriser tous les autres, c'est celui qui le porte à se concevoir adéquatement lui-même, ainsi que toutes les choses qui peuvent tomber sous son intelligence." (Ethique, IV, appendice, chap. IV, trad. Pautrat) "De ce troisième genre de connaissance naît la plus haute satisfaction d'Esprit qu'il puisse y avoir." (V, 27 Pautrat)
Béatitude et affectivité : "Que si la Joie consiste dans le passage à une plus grande perfection, la béatitude, à coup sûr, doit consister en ce que l'Esprit est doté de la perfection même." (Ethique, V, 33 scolie, trad. Pautrat) "La béatitude se définirait donc par la libération de l'âme de toute idée dont la cause serait extérieure à elle : en cela, elle est systématiquement active et donc constamment joyeuse, ce qui fait d'elle un état de perfection acquis. Toutefois on peut concevoir qu'une transitivité existe dans cette intériorité, et que des manifestations de joie s'y déroulent, car l'âme ne peut être dite active que si elle manifeste des comportements actifs. Par conséquent, chaque fois que l'âme accède à l'essence de telle ou telle chose, elle ressent une joie particulière qui participe à cet état de béatitude dans lequel elle évolue." (...) "Si donc il semble délicat de confondre sans réserve la béatitude et le contentement, qu'il soit permis d'avancer la proposition suivante : peut-être faut-il conférer préférentiellement à la béatitude cette caractéristique d'être un état traduisant l'activité immanente de l'âme (donc sa pleine activité et conséquemment la perfection elle-même), et accorder à l'animi acquiescentia la valeur d'un sentiment participant à cet état de béatitude, et qui en constituerait une nouvelle fois le mobile et le vécu affectif. Si la béatitude consiste à connaître parfaitement, alors le contentement manifeste cette puissance, en exprimant le désir de connaître plus, en provoquant dans l'âme une joie toujours plus grande. Cette hypothèse permet ainsi de conserver une transitivité dans la béatitude, mais également d'y maintenir complètement l'activité du conatus, c'est-à-dire l'expression dynamique essentielle de l'homme, qui ne doit pas cesser d'y manifester l'effort de l'individu " (F. Wictor, Le Contentement...) mais il y a une "difficulté d'associer l'état de béatitude et le dynamisme joyeux du contentement," (id) Descartes dans une lettre à Elisabeth : " la béatitude consiste, ce me semble, en un parfait contentement d'esprit et une satisfaction intérieure "
Bien et mal : "Le bien et le mal ne sont que des manières de penser qui doivent disparaître avec la connaissance de l'être tel qu'il est."<puisque la réalité est la perfection> (Ethique, intro. Caillois p.32) "tout ce qui contribue à la santé et au culte de Dieu, les hommes l'ont appelé Bien; ce qui leur est contraire, ils l'ont appelé Mal." (I, appendice p.109) "Par bien, j'entends ici tout genre de joie, et, de plus, tout ce qui conduit à la joie, et principalement ce qui satisfait un désir, quel qu'il soit ; par mal, tout genre de tristesse, et principalement ce qui frustre un désir." (id, III scolie de la propo. 39) "La connaissance du mal est une connaissance inadéquate." (id, IV, proposition 64) "Sous la conduite de la Raison, nous rechercherons de deux biens le plus grand, et de deux maux le moindre." (id, IV, 65) "Sous la conduite de la Raison, nous désirerons (appetemus) un plus grand bien futur, de préférence à un moindre bien présent, et un moindre mal présent de préférence à un plus grand mal futur." (id, IV, 66) "Si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien et de mal, aussi longtemps qu'ils seraient libres." (id, IV, 68) "J'ai dit qu'est libre celui qui est conduit par la Raison seule. C'est pourquoi celui qui naît libre, et demeure libre, n'a que des idées adéquates ; et par suite il n'a aucun concept du mal et par conséquent (car le bien et le mal sont corrélatifs) du bien non plus." (démonstration de supra) "...cependant l'homme conçoit une nature humaine beaucoup plus forte que la sienne, et qu'en même temps il ne voit rien qui l'empêche d'acquérir une telle nature, il est incité à rechercher les moyens qui le conduiront à une telle perfection. Tout ce qui peut être un moyen d'y parvenir est appelé un vrai bien. Et le bien suprême est pour lui de parvenir à jouïr –avec d'autres individus, si faire se peut – d'une telle nature [supérieure]." (Traité de la Réforme de l'Entendement, §13) "Telle est donc la fin vers laquelle je tends, à savoir, acquérir une telle nature <supérieure> et travailler à ce que beaucoup d'autres l'acquièrent avec moi." (id. §14) "...je n'accorde pas que la faute et le ma soient rien de positif, encore bien moins que quoi que ce soit puisse être ou arriver contre la volonté de Dieu. Non content d'affirmer que la faute n'est rien de positif, j'affirme en outre qu'on parle improprement et de manière anthropomorphique, quand on dit que l'homme commet une faute envers Dieu ou qu'il offense Dieu." (Spinoza, Lettre XIX à Blyenbergh, 5 janvier 1665, Pléiade p.1123) "Si les hommes ne sont pas justifiables devant Dieu, c'est par la seule raison suivante : ils sont en son pouvoir comme la terre est au pouvoir du potier qui de la même manière fait les vases dont les uns sont pour la gloire et les autres pour la honte." (Lettre 75 à Henri Oldenburg, Pléiade p.1286) "...selon Spinoza, le Bien n'a pas plus de sens que le Mal : il n'y a ni Bien ni Mal dans la nature." (Spinoza et le Pb... p.232) "Mais qu'il n'y ait ni Bien ni Mal ne signifie pas que toute différence disparaisse. Il n'y a pas de Bien ni de Mal dans la Nature, mais il y a du bon et du mauvais pour chaque mode existant. L'opposition morale du Bien et du Mal disparaît, mais cette disparition ne rend pas toutes les choses égales, ni tous les êtres. Comme Nietzsche le dira, "Par-delà le Bien et le Mal, cela du moins ne veut pas dire par-delà le bon et le mauvais"<Géné. de la Morale, I, 17>." (id p.233) Bien et mal sont des êtres de raison (cf cette entrée) / "...il n'y a dans la Nature ni bien ni mal." (C.T, II, 4 §5 p.96) "Toutes les fois donc qu'une chose nous paraît ridicule, absurde ou mauvaise dans la Nature, cela vient de ce que nous connaissons les choses en partie seulement et ignorons pour une grande part l'ordre et la cohésion de la Nature entière et voulons que tout soit dirigé au profit de notre Raison; alors que ce que la Raison prononce être mauvais n'est pas mauvais au regard de l'ordre et des lois de toutes la Nature, mais seulement au regard des lois de notre nature seule." (T.T.P, XVI, p.263) "...l'Esprit est sujet à d'autant plus de passions qu'il a plus d'idées inadéquates, et, au contraire, agit d'autant plus qu'il a plus d'idée adéquates." (Ethique, III, 1, corollaire)
Bienveillance : "La bienveillance est le désir de faire du bien à celui dont nous avons pitié." (Ethique, III, définition 35 des affects) "Aussi le soin des pauvres incombe –t-il à l'ensemble de la société et concerne seulement l'utilité commune." (id, IV, chap.XVII de l'appendice)
Bon & mauvais : "Par bon, j'entendrai donc par la suite ce que nous savons avec certitude être un moyen de nous rapprocher de la nature humaine que nous nous proposons ; par mauvais, au contraire, ce que nous savons avec certitude nous empêcher de réaliser ce modèle. Ensuite, nous dirons que les hommes sont plus ou moins parfaits suivant qu'ils approchent plus ou moins de ce même modèle." (Ethique, IV, préface) "Par bon, j'entendrai ce que nous savons avec certitude nous être utile." (id, IV définition 1) "Par mauvais, au contraire, ce que nous savons avec certitude empêcher que nous ne possédions quelque bien." (id, 2) "il y a deux types d'actions : les actions où la décomposition vient comme par conséquence et non pas en principe, parce que le principe est une composition - et ça ne vaut que pour mon point de vue, parce que du point de vue de la nature tout est composition et c'est pour cela que Dieu ne connaît ni le mal ni le mauvais -, et inversement il y a des actions qui directement décomposent et n'impliquent de compositions qu'indirectement. C'est là le critère du bon et du mauvais et c'est avec ça qu'il faut vivre." (Deleuze, Cours à l'université de Vincennes, 13/01/81) "- Une chose considérée isolément n'est dite ni bonne ni mauvaise, mais seulement dans sa relation à une autre, à qui elle est utile ou nuisible pour l'acquisition de ce qu'elle aime. Et ainsi chaque chose peut être dite bonne et mauvaise à divers égards et dans le même temps." "Dieu à la vérité est dit souverainement bon parce qu'il est utile à tous; il conserve en effet par son concours l'être de chacun, qui est pour chacun la chose la plus aimée. De chose mauvaise absolument il ne peut y en avoir aucune, ainsi qu'il est évident de soi." (Pensées Métaphysiques, chap.6, p.353) cf la pomme empoisonnée "C'est le cas de la rencontre entre deux corps dont les rapports caractéristiques ne se composent pas : le fruit agira comme un poison, c'est-à-dire déterminera les parties du corps d'Adam (et parallèlement l'idée du fruit déterminera les parties de son âme) à entrer sous de nouveaux rapports qui ne correspondent plus avec sa propre essence. " (Spinoza Philosophie Pratique, pp.33-34) "il n'y a pas de Bien ni de Mal, mais il y a du bon et du mauvais. "Par-delà le Bien et le Mal, cela du moins ne veut pas dire : par delà le bon et le mauvais <Généalogie de la Morale, 1ère dissert. §17>." Le bon, c'est lorsqu'un corps compose directement son rapport avec le nôtre, et, de tout ou partie de sa puissance, augmente la nôtre; Par exemple, un aliment. Le mauvais pour nous, c'est lorsqu'un corps décompose le rapport du nôtre, bien qu'il se compose encore avec nos parties, mais sous d'autres rapports que ce qui correspondent à notre essence : tel un poison qui décompose le sang. " (id, p.34) "...sera dit bon (ou libre, ou raisonnable, ou fort) celui qui s'efforce, autant qu'il est en lui, d'organiser les rencontres, de s'unir à ce qu'il convient avec sa nature, de composer son rapport avec des rapports combinables, et, par là, d'augmenter sa puissance." (id, p.35) "...l'Ethique renverse le système du jugement. A l'opposition des valeurs (Bien-Mal), se substitue la différence qualitative des modes d'existence (bon-mauvais)." (id, p.35) "...le mal n'est rien. Car du point de vue de la nature ou de Dieu, il y a toujours des rapports qui se composent, et il n'y a rien d'autre que des rapports qui se composent suivant des lois éternelles. Chaque fois qu'une idée est adéquate, elle saisit précisément deux corps au moins, le mien et un autre, sous l'aspect d'après lequel ils composent leurs rapports ("notion commune"). Au contraire, il n'y a pas d'idée adéquate de corps qui disconviennent, pas d'idée adéquate d'un corps qui disconvient avec le mien, en tant qu'il disconvient. C'est en ce sens que le mal, ou plutôt le mauvais, n'existent que dans l'idée inadéquate et dans les affections de tristesse qui en découlent (haine, colère, etc.)" (id, pp.52-53) "...est bon ce qui augmente ou favorise notre puissance d'agir, mauvais ce qui la diminue ou l'empêche ; et nous ne connaissons le bon et le mauvais que par le sentiment de joie ou de tristesse dont nous sommes conscients." (id. p74) "La connaissance du bon et du mauvais n'est rien d'autre qu'un sentiment (affectus) de joie ou de tristesse, en tant que nous en sommes conscient." (Ethique, IV, 8) "Qu'est-ce que le mal? Il n'y a pas d'autres maux que la diminution de notre puissance d'agir et la décomposition d'un rapport. Encore la diminution de notre puissance d'agir n'est-elle un mal que parce qu'elle menace et réduit le rapport qui nous compose. On retiendra donc du mal la définition suivante : c'est la destruction, la décomposition du rapport qui caractérise un mode. Dès lors, le mal ne peut se dire que du point de vue particulier d'un mode existant : il n'y a pas de Bien ni de Mal dans la Nature en général, mais il y a du bon et du mauvais, de (225) l'utile et du nuisible pour chaque mode existant." (Spinoza et le Problème... pp.225-226) = du point de vue de la Nature, rien n'est un mal puisqu'à tout rapport détruit en correspond un autre augmenté. Le mal n'est donc que relatif à un mode fini. / Le mal ne se trouve pas plus dans l'essence : "Sans doute, une fois que nous existons, notre essence est-elle un conatus, un effort de persévérer dans l'existence. Mais le conatus est seulement l'état que l'essence est déterminée à prendre dans l'existence, en tant que cette essence ne détermine pas l'existence elle-même ni la durée de l'existence. Donc, étant effort de persévérer dans l'existence indéfiniment, le conatus n'enveloppe aucun temps défini : l'essence ne sera ni plus ni moins parfaite suivant que le mode aura réussi à persévérer plus ou moins de temps dans l'existence. Ne manquant de rien quand le mode n'existe pas encore, l'essence n'est privée de rien quand il cesse d'exister." (id p.228).
But du T.T.P : montrer que "la liberté de philosopher ne menace aucune ferveur véritable ni la paix au sein de la communauté publique . Sa suppression, bien au contraire, entraînerait la ruine et de la paix et de toute ferveur." (T.T.P, Pléiade p.606) le "...but que je me propose et qui est de séparer la philosophie de la théologie (...)" (id, p. 651) Causa sui : "Par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence, autrement dit ce dont la nature ne peut-être conçue qu'existante." (Ethique, I, Définition 1) Si la cause du Dieu "causa sui" de Descartes et bien spécifique, "Selon Spinoza, Dieu n'est pas cause de soi en un autre sens que cause de toutes choses. Au contraire, il est cause de toutes choses au même sens que cause de soi." (Spinoza et le Problème... p.149) Cause : "Tout ce qui est, est ou bien en soi, ou bien en autre chose"(Ethique, I, Axiome 1) "Ce qui ne peut être conçu par autre chose, doit être conçu par soi." (id, 2)"D'une cause déterminée donnée, suit nécessairement un effet, et au contraire, s'il n'y a nulle cause déterminée, il est impossible qu'un effet s'ensuive." (id, 3) "Si des choses n'ont rien de commun entre elles, l'une ne peut être la cause de l'autre." (id, I, proposition 3) "La puissance d'un effet se définit par la puissance de sa cause, en tant que son essence s'explique ou se définit par l'essence de sa cause." (id, V, axiome 2) Cause adéquate / inadéquate : "J'appelle cause adéquate celle dont on peut par elle-même percevoir clairement et distinctement l'effet. Je nomme, au contraire, cause inadéquate, ou partielle, celle dont on ne peut par elle seule comprendre l'effet." <Causam adaequatam appello eam cujus effectus potest clare et distincte per eandem percipi> (Ethique, III définition 1) Causes finales : "Naturam finem nullum sibi praefixum habere." "La Nature n'a aucune fin qui lui soit fixée d'avance." "Omnes causas finales nihil nisi humana esse figmenta" "toutes les causes finales ne sont que des fictions humaines" "si Deus propter finem agit, aliquid necessario appetit quo caret." "Si Dieu agit en vue d'une fin, il désire (appetit) nécessairement quelque chose dont il est privé." <ce qui plaide contre les causes finales> "Quasi ordo aliquid in Natura praeter respectum ad nostram imaginationem esset." "comme si, en dehors de l'imagination, l'ordre était quelque chose dans la Nature." "tout dans la Nature procède selon une nécessité éternelle et une souveraine perfection." .> A propos de théologiens finalistes "…ils ne cesseront ainsi de vous interroger sur la cause des causes, jusqu'à ce que vous vous soyez réfugié dans la volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance." "ils savent que l'ignorance une fois détruite, s'évanouit cet étonnement, leur unique moyen d'argumenter et de conserver leur autorité." (Ethique, I, Appendice) "L'homme, dans l'ignorance des causes véritables des choses, prend pour cause finale l'illusion née de ses désirs." (Ethique, Introduction de R. Caillois p.31) Sur la réfutation et sur la genèse de l'erreur à admettre des causes finales, voir le long développement de l'appendice du livre I
|
||||||||||||||||||